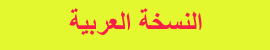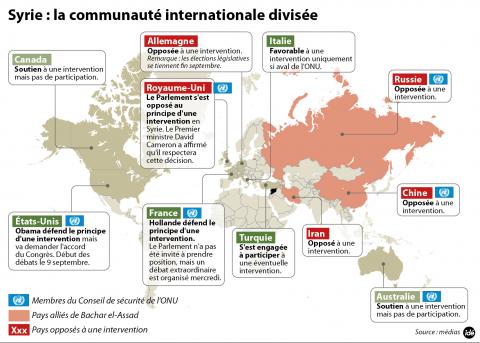
La guerre en Syrie est devenue le symbole de relations internationales «illisibles». Tentons d'y voir plus clair.
La guerre civile en Syrie s’est transformée en conflit régional et en défi international. Elle est l’illustration la plus récente de ce que le politologue Pierre Hassner appelle dans son dernier livre, La Revanche des passions. Métamorphoses de la violence et crise du politique, «l’illisibilité» des relations internationales. Et de citer Zbigniew Brzezinski, l’ancien conseiller pour la sécurité du président Jimmy Carter (1977-1981): «Le grand défi d’aujourd’hui n’est pas l’hégémonie mais le désordre.»
Le système international bipolaire de la guerre froide n’est plus pertinent et l’ordre qui s’esquissait au lendemain de la chute du communisme a volé en éclats. Il ne reste plus de grille de lecture unique des événements internationaux. Les interprétations sont multiples, elles se chevauchent, se contredisent et se complètent. C’est particulièrement vrai avec la crise en Syrie, l’apparition de Daech et l’intervention directe ou indirecte des puissances régionales et des pouvoirs extérieurs à la région.
Il est possible toutefois de tenter de mettre un peu de clarté dans une crise mouvante et complexe, au risque de la simplification. On peut ordonner les conflits autour de trois pôles: une guerre de religions entre sunnites et chiites; une confrontation pour la domination régionale; et un bras de fer entre l’Occident (les Etats-Unis) et la Russie.
1.Une explication religieuse tentante mais partielle
Comme dans d’autres conflits de la fin du XXe siècle, l’explication religieuse est la plus immédiate. On pense aux affrontements entre catholiques et protestants en Irlande du nord ou aux guerres en ex-Yougoslavie entre orthodoxes, catholiques et musulmans. Elle est tentante mais en général insuffisante ou partielle.
Sans doute la rivalité sunnites-chiites offre-t-elle une clé de compréhension. Les chiites d’Iran, d’Irak, le Hezbollah libanais, les alaouites, issus d’une scission du chiisme, qui ont été reconnus comme musulmans au milieu du siècle dernier et dont est originaire le clan Assad, se battent contre les sunnites. Le schisme remonte au VIIesiècle. Les chiites, de shi’a (parti, en arabe) se réclament du prophète Ali, quatrième calife, cousin de Mahomet dont il épousa la fille Fatima. Les sunnites se veulent les gardiens de la tradition (sunna), d’où leur nom. L’islam chiite est «ardent, mystique, contestataire, exaltant le martyre, fruit d’une histoire où [les chiites] furent toujours les plus méprisés et maltraités», comme l'écrivait récemment Henri Tincq. Il ne représente qu’environ 10 à 15% des musulmans dans le monde, sur 1,6 milliard au total.
Mais dans la guerre actuelle, la ligne de partage ne passe pas seulement entre chiites et sunnites. Ces derniers sont divisés. Si à l’origine, les monarchies, sunnites, du Golfe, en particulier l’Arabie saoudite, ont encouragé la création de Daech, leurs autres créatures, comme le Front al-Nosra, une branche d’al-Qaida, et diverses milices sunnites, comme les salafistes de Ahrar al-Sham ou le Front islamique, se battent maintenant contre l’Etat islamique. Les Kurdes, dont la religion est aussi une branche du sunnisme, sont au premier rang des adversaires de Daech.
Pour ajouter une touche religieuse supplémentaire au tableau, le patriarche de toutes les Russies, Cyrille 1er, a salué l’intervention russe aux côtés de l’Iran et de Bachar el-Assad comme participant d’une «guerre sainte». Il est vrai que depuis près de vingt ans des liens ont été noués entre le patriarcat de Moscou et les mollahs iraniens. Ils se rencontrent régulièrement à l’occasion d’un dialogue «Orthodoxie-Islam». Ils ne perdent pas une occasion de souligner que «dans le domaine de la morale publique, les deux parties s’appuient sur des valeurs similaires».
2.Iran, Turquie, Arabie saoudite: le grand jeu des puissances régionales
Derrière l’affrontement global chiisme-sunnisme se cache aussi une rivalité entre puissances régionales. Elles sont essentiellement au nombre de trois: l’Iran, la Turquie et l’Arabie saoudite. Elles peuvent bien brandir l’étendard de la religion pour justifier leur engagement dans le conflit syrien. Ce qui est en jeu aussi, et peut-être avant tout, c’est l’hégémonie dans une région qui s’étend de la mer Egée au golfe arabo-persique, qui regorge d’hydrocarbures et qui est un trait d’union aussi bien Nord-Sud qu’Est-Ouest.
L’Iran sort d’une vingtaine d’années de quasi-quarantaine, au moins de la part des Etats occidentaux. Depuis le début de la décennie 2000, il a été frappé par des sanctions internationales destinées à lui faire renoncer aux aspects militaires de son programme nucléaire. L’accord signé le 14 juillet entre Téhéran et le groupe dit P5+1 (les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU plus l’Allemagne) a ouvert la voie à la réintégration de l’Iran dans la «communauté internationale». Au-delà de la lutte contre la prolifération de l’arme nucléaire, les deux parties poursuivaient chacune un objectif à la fois convergent et différent. Toutes les deux voulaient que le pays sorte de son relatif isolement: Téhéran pour se faire reconnaître un rôle de puissance régionale; le P5+1 –surtout les Occidentaux au sein de ce groupe– afin que, fort de cette reconnaissance, le régime des mollahs joue un rôle stabilisateur dans les conflits régionaux.
Jusqu’à présent, cet espoir, qui était ouvertement celui du président Obama, a été déçu. Loin de peser pour des solutions négociées, l’Iran tente au contraire de profiter de l’instabilité régionale pour accroître son influence au Proche-Orient, en s’appuyant sur les communautés chiites ou assimilées et en s’engageant de plus en plus au côté de Bachar el-Assad en Syrie. Certes, il n’avait pas attendu la fin des négociations nucléaires pour se montrer actif dans la guerre civile syrienne. Mais au lieu de tempérer ses ardeurs, l’accord de juillet semble les avoir décuplées. Son activité en Syrie est multiforme: crédits, livraisons d’armes et de pétrole, présence de conseillers militaires et de troupes, entrainement des milices progouvernementales, écoles religieuses, etc. Les Iraniens peuvent également compter sur leurs alliés libanais du Hezbollah, très actifs en Syrie. A un point tel qu’Assad a fini par s’inquiéter et par trouver dans l’intervention russe un contrepoids bienvenu à l’ingérence iranienne.
L’Iran lutte, directement ou indirectement, sur d’autres fronts. En Irak, où il soutient le gouvernement à majorité chiite contre l’Etat islamique; au Yémen, où il arme les rebelles houthis contre le régime officiel soutenu par l’Arabie saoudite. Celle-ci mène une guerre sanglante dans ce pays à la tête d’une coalition d’Etats arabes. Sept mois de guerre au Yémen ont fait quelque 5.000 morts, dont de nombreux civils.
L’Arabie saoudite et l’Iran sont en rivalité pour l’hégémonie régionale. C’est un affrontement entre sunnites et chiites, entre Arabes et Perses, mais surtout entre deux puissances, qui ont chacune leurs «parrains» dans la communauté internationale. Les Saoudiens sont des alliés de longue date des Etats-Unis dans la région et le restent, même si des divergences liées à la fois au destin des «printemps arabes», au rôle des groupes islamistes et… au prix du pétrole ont quelque peu distendu les liens au cours des derniers mois. En proie à une forme d’instabilité dynastique, l’Arabie saoudite a cherché à garder son emprise régionale par une intervention militaire directe chez son voisin immédiat yéménite, et surtout en soutenant des formations islamistes radicales, à commencer par Daech à ses origines, avant de se retourner contre lui. Elle finance et arme des groupes extrémistes, comme le Front al-Nosra, qui se battent à la fois contre l’Etat islamique et contre le régime de Bachar el-Assad. Elle sert d’intermédiaire pour la livraison d’armes américaines aux différents groupes rebelles, parfois rivaux, que les émirats arabes du Golfe entretiennent en Syrie.
Dans ce face-à-face Iran-Arabie saoudite, la diplomatie française donne l’impression d’avoir choisi son camp, du côté des Saoudiens. Ce n’est pas nouveau. C’était déjà le cas sous la présidence Sarkozy. Cette tendance s’est toutefois accentuée depuis 2012. La France a représenté la ligne dure dans la négociation sur le nucléaire iranien, tandis qu’elle multipliait les contacts au plus haut niveau –et les contrats– avec les Saoudiens et les monarchies du Golfe. Dans une perspective à long terme, où un modus vivendi devra être trouvé entre la grande puissance chiite iranienne et les Etats sunnites, on est en droit de s’interroger sur le caractère trop unilatéral de la politique française. La vente de Rafale ou de navires Mistral à l’Egypte, largement financée par l’Arabie saoudite, ne saurait être un argument, en faveur d’un pays qui en matière de violation des droits de l’homme dépasse malheureusement l’Iran.
Pour des raisons tenant à la fois à la politique intérieure et au contexte international, la Turquie n’a pas réussi à réaliser son ambition de devenir «la» grande puissance régionale. Ministre des Affaires étrangères puis Premier ministre de Recep Tayyip Erdogan, Ahmet Davoutoglou avait théorisé l’idée d’une diplomatie «post-ottomane». La Turquie devait être le centre de gravité des pays ayant jadis appartenu à l’empire ottoman. Avec ses voisins, Ankara devait avoir «zéro conflit». Or non seulement Erdogan est sorti plutôt affaibli de ses diverses tentatives de consolider un pouvoir personnel, mais la Turquie est en délicatesse avec la plupart de ses voisins, quand elle n’est pas en conflit ouvert avec certains d’entre eux.
Après avoir été l’allié de Bachar el-Assad et tenté une médiation au début du conflit en 2011, la Turquie s’est rangée aux côtés des adversaires du régime de Damas. Elle a eu une attitude pour le moins ambigüe dans les premiers mois de l’avancée de l’Etat islamique. Elle y voyait une arme non seulement contre Assad et contre la mouvance chiite soutenue par l’Iran, mais surtout contre les Kurdes, notamment ceux du parti kurde syrien (PYD) allié du PKK, le parti extrémiste kurde de Turquie. Or Erdogan, après avoir donné l’impression de vouloir trouver un accord avec le PKK, a choisi de relancer la guerre contre lui.
Concentrés au nord du pays, le long de la frontière turque, les Kurdes de Syrie ont eu une attitude changeante et ambivalente envers le régime Assad, tantôt le soutenant, tantôt s’y opposant. Ils sont, avec le soutien américain, parmi les plus farouches ennemis de Daech, mais comme alliés du PKK, ils sont combattus par la Turquie, elle-même membre de l’Otan et alliée des Etats-Unis.
Ce n’est qu’un des paradoxes de cette nouvelle guerre du Proche-Orient. L’adage classique «les ennemis de nos ennemis sont nos amis» est trop limpide pour s’appliquer à une réalité complexe où nos ennemis agissent parfois comme des alliés et où nos amis prennent le visage de l’adversaire. Et encore faudrait-il ajouter à la complexité en évoquant la position d’Israël. Hostile à l’accord sur le nucléaire iranien, Jérusalem s’est accommodé du régime Assad en Syrie pour autant qu’il ne constituait pas lui-même ou par Hezbollah interposé une menace dans le Golan, et que son soutien au Hamas palestinien restait dans des limites acceptables. Le gouvernement israélien fait face dans les territoires occupés à une nouvelle révolte qui, pour le moment, semble déconnectée de l’embrasement général proche-oriental.
3.Etats-Unis-Russie, une nouvelle Guerre froide?
La situation est rendue encore plus difficile à déchiffrer par le jeu des puissances extérieures. L’intervention presque concomitante des Etats-Unis et leurs alliés, occidentaux et arabes, d’une part, de la Russie accourue au secours d’Assad et en appui à l’Iran, d’autre part, confère au conflit un aspect Est-Ouest qui rappelle le temps de la Guerre froide. Comme à l’époque, les deux camps évitent de s’affronter directement –en Ukraine, les Occidentaux ont refusé, avec raison, le choc frontal avec la Russie–, mais se livrent une guerre par procuration. Au moins sur le terrain.
Il en va autrement dans les airs. Les aviations des deux camps sont présentes, sans compter les appareils israéliens qui veillent à empêcher le Hezbollah de transférer des armes lourdes vers le sud-Liban. Russes et Américains se parlent pour éviter des incidents qui pourraient dégénérer. Russes et Israéliens aussi. Il n’en reste pas moins que sous couvert de lutter contre un ennemi commun, Daech, chacun travaille au succès de ses protégés respectifs.
La Syrie, la guerre contre l’Etat islamique, sont devenus un enjeu dans la rivalité entre la Russie et les Etats-Unis. Vladimir Poutine s’est engouffré dans le vide laissé au Proche-Orient par le retrait américain. Retrait relatif car contrairement à ses intentions premières, Barack Obama a été obligé de revenir en Irak mais retrait tout de même qu’il avait théorisé. Le président américain défend, dans les affaires internationales, une doctrine de la «retenue» (restraint), selon l’expression de l’éditorialiste du New York Times Roger Cohen.
Vladimir Poutine a saisi l’occasion qui se présentait. Il l’avait déjà fait à l’été 2013 quand Barack Obama avait renoncé à frapper le régime de Damas, qui avait utilisé des armes chimiques contre la population civile. Depuis le mois de septembre, il fournit une couverture aérienne à des troupes au sol –volontaires iraniens et milices pro-Assad– alors que les Occidentaux cherchent depuis des mois les troupes au sol qui viendraient en appui de leurs frappes aériennes. Ils ne les ont pas trouvées, à l’exception des peshmergas kurdes irakiens.
Il est trop tôt pour savoir comment se terminera ce bras de fer. Il n’est pas exclu que la Russie, qui a déjà envoyé plusieurs centaines de «conseillers» et de «volontaires» en Syrie, se retrouve embourbée, comme l’URSS naguère en Afghanistan. Dans l’immédiat, en tous cas, Vladimir Poutine a réussi à redevenir un interlocuteur indispensable, après avoir été chassé des grands forums internationaux à cause de l’annexion de la Crimée et de la guerre dans le Donbass.
Il prend aussi sa revanche de la Libye. Son successeur éphémère, Dmitri Medvedev, avait eu la faiblesse de laisser passer au Conseil de sécurité une résolution dont les Occidentaux ont fait une interprétation extensive pour renverser Kadhafi. En Syrie, le président russe montre qu’on ne l’y prendra plus. Il ne s’agit pas seulement d’une forme de ressentiment. C’est une profession de foi politique: les régimes, fussent-ils autoritaires, ne peuvent pas être changés par la rue ou par des interventions extérieures. Le principe vaut aujourd’hui pour Assad. Il pourrait valoir demain pour Poutine lui-même.
Source : http://www.slate.fr/story/108409/guerre-syrie-trois-cles-puzzle