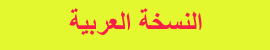Nous avions l’habitude, mes compagnons et moi, de nous réunir trois fois par jour, à l’aube, vers deux heures de l’après-midi et au crépuscule, qui pour réciter le Saint coran, qui pour étudier l’exégèse du corpus religieux malékite, qui pour approfondir des connaissances en langue arabe. A l’ombre d’un grand arbre qui jouxtait en général la tente de l’Erudit Ahmed Salem ou sous cette dernière pour les plus petits, les sempiternelles demandes des récitants: «Talebna, Smaani!» (Maître, écoute-moi!) et la réponse de ce dernier: «Mach-chi!» (Récite!), ponctuaient les heures d’études durant la journée. Les études de nuit, moins intenses, du moins pour les plus petits, s’effectuaient à la lueur d’un grand feu de bois, allumé devant la tente de l’Erudit. Chaque apprenant devait ramener quotidiennement une bûche «proportionnelle» au niveau de ses études, pour alimenter ce feu collectif. Le spectre des connaissances de l’Erudit était large au point qu’il était en mesure d’évaluer les niveaux de dizaines d’apprenants, dans différentes disciplines, dans une ambiance d’intense compétition où les décibels constituaient les seules «munitions» autorisées! En réalité, l’Erudit «écoutait» toute la classe, ceux qui venaient «réciter», tablette en bois entre les mains, mais aussi ceux qui «mûrissaient leur leçon», en profondeur de notre assemblée, assis à même le sol, les genoux surélevés, tablette tenue bien droite à une ou deux mains; il ne se privait pas de redresser la prononciation ou de corriger les erreurs de texte, au profit de l’un ou l’autre des apprenants, en l’appelant par son prénom ou, à l’occasion, par son sobriquet! Il arrivait qu’il fît l’injonction, à l’un d’entre nous, de réciter à plus haute voix. La fin de la séance matinale d’études était généralement consacrée aux nouvelles leçons; les apprenants, à l’exception des débutants, écrivaient eux-mêmes leur nouvelle leçon, sous la dictée de l’Erudit ou de l’un de ses disciples, par lui désigné. Les débutants tendaient leur tablette pour se faire écrire la lettre vocalisée ou pas, la ligne ou le paragraphe pour mémorisation; les plus doués arrivaient à réciter leur leçon par cœur, avant le dessèchement de l’encre qui avait servi à son inscription! D’autres avaient besoin d’un temps plus ou moins long, généralement pas plus de vingt-quatre heures. L’Erudit savait adapter la longueur du texte à chaque apprenant, car il était passé lui-même par ce système éducatif multigrade, y avait exercé durant de longues années et connaissait chacun de ses ouailles depuis la naissance. L’intermède consacré à la préparation de l’encre à écrire, offrait toujours un précieux moment de détente et de travail manuel partagé; des pierres de différentes formes et tailles, avec la particularité commune de comporter un creux pratiqué dans la partie supérieure, nous servaient d’encriers. Certains encriers étaient plus esthétiques que d’autres… Pour préparer l’encre, on versait un peu d’eau dans le creux de l’encrier, on y ajoutait de la gomme arabique; avec une brindille, on remuait suffisamment longtemps le mélange pour faire dissoudre la résine. Muni d’un charbon de bois («Talh», Acacia raddiana, de préférence), on frottait délicatement sur le bord de l’encrier, de manière à éroder finement le charbon, tout en remuant régulièrement la solution, le temps nécessaire pour que la solution fût saturée en poudre noire. A l’aide d’un calame, une tige sèche d’une plante pérenne («Sbat», Stipagrostis pungens) qui pousse dans le grand désert, ou, à défaut, d’une graminée ( «Om rokba», Panicum turgidum), taillée en biais à l’un de ses bouts et fendue à l’extrémité, on testait l’encre obtenue sur notre tablette en bois; il arrivait que l’on ajoutât quelques gouttes d’eau, un soupçon de gomme arabique ou que l’on frottât davantage le morceau de charbon sur le bord de l’encrier, en guise de dosage ultime. Il ne nous restait plus alors qu’à nous rapprocher du maître, tablette à la main, en vue de nous faire dicter notre nouvelle leçon. (A suivre)
category: