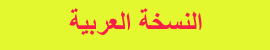Un homme de chez moi s’est égaré au fond de nulle part. L’homme était un chasseur. Il l’est toujours. Peut-être. En tout cas, il en avait la passion. L’une de ces passions qui naissent et qui croissent, à l’intérieur de l’âme, et qui meublent l’esprit, et qui grandissent , et dépassent , quelquefois, et l’âme et l’esprit et le corps même. Le genre de passion pour la chasse qui projette son auteur – oserait-on, dire, vraiment, dans ce qu’on dit, auteur, tellement on ne sait, dans ce cas précis où se situe l’auteur- dans un état sans nom, ni verbe, c’est le cas de le dire, ni sujet. L’action se perd. Se confond et s’imbrique avec son sujet et son complément, qui se pose dans un quelque part si incertain que même Samuel Beckett, en personne ne saurait le démêler de ses improbabilités martingales. En formant ainsi un état de non langage, où la grammaire normative se meurt et devient néant. L’homme, pour le dire, était la passion ; la chasse même. Un chasseur, c’est vrai, mais c’est juste un nom générique, pour ne pas dire arbitraire, à l’instar de l’arbitraire, intimement lié aux noms et la création première des noms. L’homme était chasseur à l’instant où il partait à la chasse. Il l’était l’instant d’avant et tous les instants antérieurs de sa vie. Dans son égarement, il était encore chasseur.
Il était parti un jour, qu’il appelait un jour de chasse. Un véhicule qu’il a équipé, sans rien oublier, du détail le plus insignifiant, au viatique le plus précieux pour affronter des journées et des soirées de chasse en plein désert. Il était parti seul. Seul à bord de son véhicule tout terrain. Seul, sans apprenti, ni serveur. La chasse, pour lui, était une religion qui se pratique dans la ferveur de la solitude. Plus on s’isole avec elle, plus on l’apprécie. Plus elle se fait loin des regards témoins, mieux elle s’accomplit. Le gibier, à ses yeux de moine de la chasse, pourrit au contact des regards d’autrui.
Ses premiers jours se passèrent plutôt bien. A merveille, plus qu’il ne le souhaitait, et tel qu’il en avait la certitude, la veille de son départ de la ville. Chaque nuit, il campait au milieu d’un nulle part, dont il connaissait chaque coin et recoin. Et il passait sa soirée, proche de son feu, à se délecter de la quiétude des délices de la dégustation solitaire. Chaque jour, son bolide accueillait de nouvelles races de gibier. De proies en proies, le véhicule était, à lui seul, un croisement de cris d’hallali. Un rendez-vous roulant et un déroulé de victoires.
Le désert était d’une connivence certaine avec l’homme. Le vent murmurait son souffle comme s’il surgissait du bon vouloir de l’humeur du chasseur. Les dunes et les arbres et le gibier et tous les éléments de la nature avaient juré alliance pour faire allégeance à l’homme.
Tout allait bien pour lui. Si bien que la réussite devient, pour lui, une routine. Une seconde nature. Une nature dans la nature. La proie apparaissait à chaque fois au moment propice et gisait sur le sol après chaque tir de fusil. Chaque jour, le succès d’une chasse suscitait chez lui, davantage le sentiment d’invincibilité. Il se croyait désormais maître et de la chasse et du désert même où s’opérait la chasse. Un goût du statu quo naissait et grandissait chez en lui. Il oubliait que d’autres univers avaient existé un jour. Et n’avait d’esprit que pour ce qui était devenu un automatisme quotidien. Les jours se succédaient. Et les soirées. Chaque journée, chaque soirée, chaque instant d’aujourd’hui ressemblait, mystérieusement, gracieusement, à son semblable d’instant d’hier.
Un jour, il se réveilla au petit matin à cause d’une soif trop matinale. Il avait assez d’eau. Enfin, c’est qu’il croyait. Tellement, les choses s’arrangeaient, d’elles-mêmes par le passé, qu’il était certain de son eau. Comme il était sûr de tout, tous les jours. Mais dans sa réserve d’eau, il ne restait qu’un fonds qui étanchait à peine sa soif et le soleil se levait, pour une fois, avec une mauvaise mine. Ce n’était, certainement, pas le visage, qu’il lui connaissait ses journées précédentes. Ses rayons le piquaient sur tout le corps ; le pénétraient jusqu’aux entrailles ; asséchaient, en lui, chaque source d’assurance née de la régence chimérique de ses nulles parts. Une bourrasque surgissait d’entre ses pieds. Et son univers s’assombrissait. Et le vent devenait de plus en plus chaud.
Il monta dans son véhicule. Le démarra, et roula toute la matinée durant dans des paysages inconnus. En milieu de journée, le voici qui s’arrêtait. Il avait mille choses dans la tête. Il n’avait plus aucune goûte d’eau. Le carburant de son véhicule était limite. Les gibiers qu’il avait entassés un peu partout dans la cabine de son automobile dégageaient l’odeur d’un faisandage corrompu. Il accélérait la vitesse. Et plaçait, au fur et mesure qu’il accélérait la vitesse du bolide, le volume du magnétophone incorporé dans son véhicule à fond.
Un peu avant le crépuscule, il se retrouva stationné devant une tente de bergers. Visage terreux, lèvres gercées ; il suppliait son hôte de lui donner une cassette de musique. Et qu’il était lassé, lui disait-il, de réécouter mille fois les mêmes chansons.
Tu es sûr que tu n’aurais besoin en pareille nuit que d’une nouvelle musique ? Aurais-tu suffisamment d’eau pour continuer ta randonnée de chasse ? Et ton gibier ? N’aurait-il pas besoin d’être traité ? Je sens bien une odeur qui ne me rassure guère ! Tu es vraiment certain de ta musique, lui lançait le berger, dans son ultime tentative de raisonner le passionné de la chasse, en lui tendant une cassette de musique ! ?...
Croyant qu’il s’était procuré, enfin, la musique qui irait faire revenir le jeu d’équilibre du désert. Et qu’il s’était, pour de bon, libéré d’une musique qui le dérangeait et dérangeait sa solitude paisible, il allait poursuivre son chemin. Pas le sien. Un chemin, parmi mille. Qui le conduisait au fin des nulles parts, les vrais, ténébreux et impitoyables. Une soirée. Puis une demie-matinée, et il était quelque part, langue pendue, haletante de soif. Sans eau. Ni le moindre soupçon de vapeur de carburant pour avancer un instant vers l’inconnu. Une heure passait. Puis une autre. Une journée. La soirée d’après. Et l’homme mourrait petit à petit. Sur fonds d’une musique dont il songeait, l’instant d’une errance sans fin, qu’elle saurait étancher sa soif…
Abdelvetah Alamana
category: