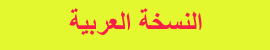La mort du fondateur de Jeune Afrique (JA) vient d’être annoncée il y a quelques heures. Préalablement, Bechir Ben Yahmed (BBY) avait pris toutes les dispositions pour assurer la continuité du journal. Et il s’en était expliqué plus de six mois avant son décès lors d’une interview réalisée par JA.
En Guise d’hommage à cette grande icone de la presse francophone mondiale, et belle voix de l’Afrique et du Moyen-Orient, mauriactu.info publie l'épisode de son interview où il annonce, preuves à l’appui : « Je veux que le journal me survive. »
Jeune Afrique : Comment voyez-vous le journal une fois que vous serez parti ?
D’abord, contrairement à une légende colportée par certains, je veux qu’il me survive, et il est en train de me survivre. Comme vous le savez, je ne m’en occupe plus du tout depuis plus de deux ans. J’ai délégué totalement le pouvoir, tant sur la rédaction que sur la gestion.
Si j’ai créé La revue, c’est parce que cela m’intéresse, bien sûr, car c’est un projet que je nourris depuis vingt ans, mais c’est aussi parce que je veux m’occuper d’autre chose pour ne plus être tenté d’intervenir dans Jeune Afrique : il faut toujours trouver un intérêt de substitution. Et La revue, je m’en occupe à 100 %.
Je me suis longtemps posé la question – et on en revient aux problèmes de dynastie : « Est-ce que ce seront mes enfants ou non qui me succéderont ? » Je n’ai pas trouvé d’autre solution que l’héritage. Donnez-moi une autre solution, il n’y en a pas. J’ai pensé à une fondation. Mais ça ne donne que des fonctionnaires et des bureaucrates. Cela ne marche pas.
Je sais, bien sûr, que Jeune Afrique sans moi sera un autre Jeune Afrique. Aujourd’hui, c’est François Soudan, mais quand arrivera le tour de mes enfants, ce sera en plus une autre génération, une autre sensibilité. Si, par chance, et comme je l’espère et le leur recommande, ils continuent de respecter les quelques principes sur lesquels je me suis appuyé et que nous avons un peu évoqués – l’indépendance, la lutte contre la dictature, la primauté de l’intérêt général sur l’intérêt particulier –, alors tant mieux.
Donc vous assumez cette contradiction de dire que l’héritage, ça ne marche pas pour un État, mais ça marche pour un journal ?
Pour une entreprise, y compris de presse, je ne connais pas d’autre solution. Qu’on me montre, je veux bien essayer. Un État n’appartient pas à celui qui le gère. Celui-ci ne fait que passer. Il peut tout au plus orienter la succession. Mais moi, cela m’appartient, et je n’y peux rien : c’est la loi du capitalisme et aucun autre système que le capitalisme n’a fonctionné durablement.
Vous savez, ce journal m’appartient par hasard, parce que personne d’autre n’a voulu le faire. Au début, j’avais un rédacteur en chef qui était mon alter ego. Au bout d’un mois, il m’a dit : « Je pars en vacances. » Je lui ai dit : « Comment ça, tu pars en vacances, on n’est que deux ou trois à faire le journal ! » Il a dit : « Je pars dix jours. Ma petite amie est en Corse. Je vais la rejoindre. » C’est la différence. Je ne partais pas en vacances, et quand Jeune Afrique était au fond du trou, c’est moi qui empruntais de l’argent, vendais mes biens et donnais en gage tout ce que je possédais. Sans cela, Jeune Afrique n’aurait pas été sauvé et n’aurait pas survécu…
L’équipe actuelle, c’est François Soudan, Amir et Marwane Ben Yahmed. Quels conseils leur donnez-vous ?
C’est la direction de la rédaction. François Soudan est à Jeune Afrique depuis plus de trente ans et y est arrivé directement en sortant de Sciences-Po et de l’École de journalisme de Lille. Je l’ai choisi parce qu’il était en situation d’assurer la direction de la rédaction. Si j’avais obéi à une logique dynastique, j’aurais choisi Amir ou Marwane, ou Amir et Marwane, et, dans ce cas, François Soudan aurait été, s’il l’avait accepté, leur adjoint.
Mais c’est avec François Soudan que je discute et il est pleinement le directeur de la rédaction. Il se trouve que Marwane est un rédacteur en chef capable et qu’Amir est un bon gestionnaire. L’un et l’autre ont plus de dix ans de maison. Je ne les ai pas choisis uniquement parce qu’ils sont mes fils et qu’ils étaient là. S’ils n’avaient pas été capables ou désireux d’assumer leurs fonctions, ils ne seraient pas là où ils sont.
Le mieux que j’aie pu faire était de quitter la direction du journal alors que j’étais encore en bonne santé et opérationnel. Et de voir comment cela fonctionne, et d’essayer d’aider François Soudan et mes enfants, de loin, sans interférer.
François Soudan, mon épouse Danielle, Amir et Marwane se partagent assez bien l’ensemble des tâches de direction au niveau de l’entreprise au sein d’un comité de direction présidé par Danielle, qui, elle, est dans l’entreprise depuis notre mariage… il y a quarante et un ans. Elle a appris le métier, gravi les marches et, comme François Soudan, était en situation.
Deux cadres dirigeants de qualité complètent le comité de direction du Groupe : Jean-Baptiste Aubriot, DGA et Monsieur Finance, et Philippe Saül, directeur marketing et diffusion.
Vous souhaitez aux quatre de continuer de s’entendre pendant de nombreuses années, c’est cela ?
Oui, mais je ne sais pas ce qui se passera lorsque François Soudan ne sera plus là. Il n’est pas éternel. Tant que lui et moi serons là, Jeune Afrique est protégé et cela marche. Quand il ne sera plus là, ou que je ne serai plus là, je ne sais pas. Ce sera le début d’une autre ère. Là, je fais au mieux dans la limite de mes forces. Après ce n’est plus de ma compétence.
Et La revue, est-ce la démarche de quelqu’un qui est fatigué de Jeune Afrique ?
Pas du tout. Ma démarche obéit à une logique consciente ou inconsciente : j’ai commencé en 1955 par L’Action, un hebdo tunisien. Je l’ai ensuite, en 1957, élargi au Maghreb. Il couvrait l’Algérie en pleine guerre d’indépendance et le Maroc.
Avec Afrique Action, en 1960, devenu Jeune Afrique en 1961, j’ai élargi un peu plus encore le champ d’action, cette fois à l’Afrique tout entière, au nord comme au sud du Sahara. Il y a donc un élargissement de l’horizon et de la perspective.
Nouveau et très grand changement avec La revue, l’ultime. Mon ambition, si j’y arrive, est de faire de La revue le premier mensuel généraliste de langue française. Avec l’équipe qui se constitue progressivement, nous voulons faire l’un des meilleurs mensuels internationaux. Rien de moins. C’est un très grand challenge. J’y mets toute mon expérience, tous mes moyens, comme je l’ai fait pour Jeune Afrique, et je pense que nous allons finir par le réussir dans les cinq ans qui viennent. Comme vous pouvez le voir, j’ai tendance à embrasser des ambitions qui dépassent mes moyens…
Je précise que La revue ne fait pas partie du Groupe Jeune Afrique mais d’une société indépendante : sa réussite rejaillira sur le groupe ; un éventuel échec ne retentira que sur moi.
Avant même de me lancer dans l’aventure, je rêvais, ambition folle que je n’ai jamais avouée, pas même à moi-même, d’être à la tête d’un grand journal connu et reconnu dans le monde entier.
C’était, comme disait Bourguiba, « un rêve de jeunesse qu’on réalise à l’âge mur ».
La longévité fait que je peux espérer y arriver ou du moins m’en approcher.
En poussant mon raisonnement jusqu’au bout, je ne suis pas mécontent de ne pas avoir fait de politique. Je regarde tous mes camarades de promotion du Tiers Monde. À part quatre ou cinq qui ont eu la chance de changer le destin de leur pays, les autres, je ne les envie pas du tout. Moi, au moins, j’ai été maître de mon destin. Tout ce que j’ai fait de bon ou de moins bon, j’en suis responsable… en dernier ressort.
Et le croyant que je suis remercie ses parents de lui avoir donné la vie et, plus encore, de l’avoir éduqué, comme il remercie Dieu de l’avoir aidé dans la voie qu’il s’est choisie, de lui avoir donné le temps, la santé et la volonté de réaliser – ou presque – son rêve de jeunesse.
Source: Jeune Afrique.
category: