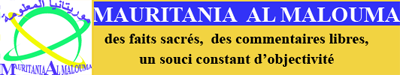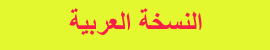Chaque mois, des chercheur·ses spécialistes du Sahel livrent leurs réflexions, leurs éclairages, leurs amusements, leurs colères ou leurs opinions sur la région. Aujourd’hui, le point de vue de Ferdaous Bouhlel, chercheuse indépendante et consultante en médiation de paix et gestion des conflits.
Le 25 janvier 2024, la junte au pouvoir à Bamako a officiellement mis fin à l’accord d’Alger signé près de dix ans plus tôt avec les mouvements rebelles indépendantistes du nord du Mali. Rejetant à la fois ses organes d’exécutions, ses principaux acteurs, son contenu et ses garants. Cette posture s’est accompagnée d’un changement d’alliance en faveur de la Russie, désormais protectrice du gouvernement malien.
La création du Front de libération de l’Azawad en novembre 2024 (regroupant la plupart des mouvements armés non-jihadistes), l’intensification des conflits dans le centre et le nord du Mali, le départ massif de centaines de milliers de réfugiés, ainsi que la multiplication des attaques envers les civils, sont les dénominateurs d’une escalade du conflit qui est bel et bien en marche.
Face à ces changements et à une telle dégradation de la situation sécuritaire, quid de la médiation et d’une sortie de crise ? Qui en est le garant ? Y’a-t-il un acteur pour relancer le processus et en défendre le principe ?
Par le rejet en cascade de ses anciens alliés européens, la junte malienne entend se réapproprier les contours et le contenu du jus post bellum, c’est-à-dire le droit relatif aux modalités de conduite de la paix, qui implique le processus de désignation « morale » des acteurs de la paix. En d’autres termes, il s’agit de pouvoir dire qui est accepté ou pas à la table des négociations. Cela a donné lieu à deux phénomènes :
D’une part, en retirant aux groupes signataires de l’accord d’Ager la personnalité morale que renferme ce droit de belligérance, puis en les qualifiant de « terroristes », le gouvernement malien leur a retiré le droit de défendre leur cause et en quelque sorte le droit au dialogue. Ce déni de reconnaissance constitue un recul sans précédent dans le processus de paix au Mali.
Deuxièmement, la limitation de l’entremise étrangère, conjuguée à une méfiance envers ses anciens alliés, a donné lieu à un désengagement du gouvernement envers le principe même de médiation internationale. Cette dernière a été supplantée par un phénomène de « nationalisation » du dialogue de paix, « par les Maliens et pour les Maliens » qui offre certes une formidable opportunité de valoriser les leviers endogènes mais comporte aussi des interrogations sur la portée et la capacité du dispositif. L’approche choisie par le gouvernement escompte la reddition des groupes armés à la faveur d’un renversement des rapports de force. Des émissaires communautaires ont été chargés de ramener « les brebis galeuses » qui souhaiteraient rejoindre leur patrie. Pourtant, les recommandations du dialogue inter-malien de mai 2024 concluaient justement à la nécessité « d’engager un dialogue avec les mouvements armés maliens », y compris avec le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim, affilié à Al-Qaeda). Auquel cas, comment l’Etat peut-il être à la fois partie au conflit et médiateur ?
La théorie de gestion des conflits rappelle qu’il faut parfois toucher le fond pour voir émerger un espoir de désescalade. Nous n’avons hélas pas de baromètre précis pour jauger de ce fond. De la même façon, l’intensité de la violence déployée par les belligérants ne constitue paradoxalement pas le principal frein au dialogue, même si elle peut laisser de profondes cicatrices et rancœurs. La guerre est un acte de violence, qui n’a pas vocation à « s’auto-limiter » (la théorie de Clausewitz rappelle qu’en théorie, la guerre est liée à la notion « d’absence de limites »). On conviendra donc que la restriction de la violence ne peut venir que de lieux exogènes à sa production (la société, le contexte, les normes locales etc.).
Il y a théoriquement deux modalités de limitations de la logique de guerre : la force elle-même, déclenchée par une action réciproque et continue (l’escalade en cours), ou le choix humain et rationnel de mettre le curseur sur ce que cette violence renferme comme signification, et c’est bien là le sens du dialogue.
Enfin, on a tendance également à considérer que ce dialogue est une affaire de seule volonté des acteurs, en occultant la part immense jouée par l’opportunité. Or, il n’existe pas « d’esprit du dialogue », qui descendrait, telle une révélation, dans un moment de grâce. Ni d’envie soudaine de tendre la main à son ennemi. Le dialogue est un acte délibéré, travaillé et consenti par un ensemble d’acteurs concernés par le conflit, c’est un dispositif qui a vocation à fabriquer des opportunités.
La polarisation internationale (Russe contre Européens) interposée aujourd’hui autour du conflit malien contribue à rendre impossible un dialogue déjà agonisant et à renforcer les postures radicales des belligérants. Aujourd’hui, plus aucun acteur international ne semble vouloir consentir et garantir l’option du dialogue. Il semble pourtant impératif de réaffirmer les valeurs et le contenu originel du principe de médiation, qui est de trouver par tous les moyens, les voies de la désescalade, que l’on soit en conformité morale et politique (ou pas) avec les parties prenantes en conflit, uniquement pour le principe de chérir et de garantir la paix.
Par Ferdaous Bouhlel
Chercheuse et consultante en Médiation de paix et gestion des conflits
-----------------
*Article paru dans le journal LIBÉRATION, le 20 février 2025 :
https://www.liberation.fr/international/afrique/au-mali-la-junte-rejette...
category: